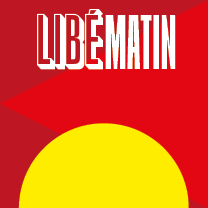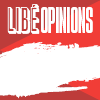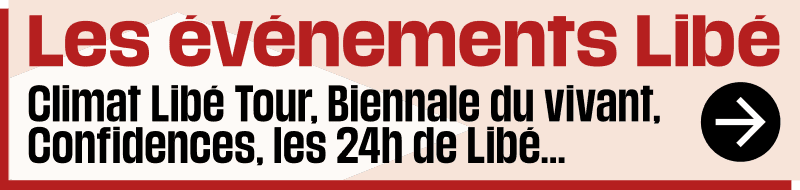En 1993, François Mitterrand prononçait cette phrase restée célèbre : «Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé.» Le président socialiste semblait alors se résigner à une forme d’impuissance publique. Quelques crises et plans d’austérité plus tard, l’idée que l’Etat ne peut pas tout et que c’est aux départements de prendre le relais a fait son chemin. Le département, c’est l’Etat en petit, et le cadre idéal pour expérimenter des politiques, les tester grandeur nature avant de les généraliser.
Pour la deuxième année de suite, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) accueille une journée de débats autour de l’expérimentation locale. Son nom : «La France qui essaie». Libération est partenaire de l’événement avec les associations Solutions solidaires et Départements solidaires, ainsi que la Fondation Jean-Jaurès, pionnière sur cette question qui abrite le bien nommé Observatoire de l’expérimentation et de l’innovation locales.
Lors de l’édition 2023 du forum, Laurent Grandguillaume, président de Territoires zéro chômeur de longue durée, était revenu sur ce dispositif lancé en 2015 à partir d’une idée simple mais lumineuse : utiliser une partie des fonds dédiés à la prise en charge du chômage pour financer l’embauche en CDI de chômeurs longue durée par des entreprises locales de l’économie sociale et solidaire. «Je n’aurais pas pu imaginer que cette utopie deviendrait réalité à travers une loi, puis par la création d’une dizaine d’entreprises dans dix territoires expérimentaux, et l’embauche de plus de 800 personnes en CDI en moins de deux ans», se réjouissait l’ex-député socialiste en 2019. Mais pour cela, «nous avons dû soulever des montagnes et dépasser des conservatismes qui ne voulaient pas laisser place à l’expérimentation, réfractaires à l’idée de tester un projet dans les territoires qui échappe à des logiques bureaucratiques».
Les jeunes, angle mort des politiques de solidarité nationales
Depuis, d’autres initiatives locales se sont inspirées de cette démarche pilote. Elles seront présentées lors du forum, et certaines le sont dans ce cahier. Par exemple, le département de la Meurthe-et-Moselle a fait de l’accès aux droits son cheval de bataille, avec l’expérimentation «Territoire zéro non-recours». De son côté, grâce aux économies permises par la recentralisation du RSA, la Seine-Saint-Denis expérimente un meilleur accompagnement des allocataires vers l’emploi à travers son programme «Nouvelle Donne de l’insertion».
Le département des Landes a choisi, lui, de mettre l’accent sur le vieillissement et les métiers du lien quand l’Hérault cherche à améliorer sa politique de protection de l’enfance. Le département occitan a ainsi mis sur pied un Comité des jeunes destiné à ceux qui furent, ou sont encore, placés en foyer ou en famille d’accueil. Si cette instance est consultative, ses participants ont été associés à l’élaboration du schéma départemental enfance et famille, et témoignent deux fois par an lors des formations de travailleurs sociaux. Une manière de donner une voix aux enfants «placés».
Angle mort des politiques de solidarité nationales, les jeunes sont également au cœur de l’attention du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Pour faciliter un projet ou faire face à une difficulté passagère, le département lorrain ainsi mis en place un «revenu d’émancipation jeunes» de 500 euros par mois pour les 16-24 ans. «Nous misons sur la responsabilisation des jeunes, expliquait sa présidente Chaynesse Khirouni en janvier. A la différence d’autres aides, nous ne leur demandons pas de s’engager dans un contrat. Nous voulons tester une nouvelle façon de les accompagner, souple et adaptée, et voir si notre confiance leur permet d’enclencher une démarche dynamique.» Le département a alloué un budget de 600 000 euros à cette expérimentation soit 200 jeunes aidés pendant six mois. Le forum au Cese sera l’occasion de tirer un premier bilan qui, s’il est positif, pourrait convaincre d’autres départements de s’en inspirer.
Des expérimentations doublement rentables
Quant au conseil départemental de Haute-Garonne, il a innové dans un autre domaine : l’éducation et la mixité scolaire. En 2017, dans le sillage d’expérimentations encouragées par l’Education nationale, il fermait deux «collèges ghettos» du quartier du Mirail et affrétait des bus vers des établissements mieux cotés du centre-ville et des zones pavillonnaires. Le temps de reconstruire deux nouveaux établissements, mieux situés et permettant plus de mixité. Et ça marche : «Les résultats chiffrés, de réussite au brevet et de ce que nous voyons sur le terrain, sont extrêmement positifs», témoignait Choukri Ben Ayed, professeur de sociologie, dans Libération en 2021. Il n’en doutait pas une seconde : «Je l’ai toujours dit. Il n’y a pas de fatalité.»
D’autres départements tentent de remédier aux fractures environnementales ou territoriales. La Gironde teste ainsi une «Sécurité sociale de l’alimentation», tandis que la Nièvre cherche à améliorer l’accès à la santé dans la ruralité.
L’intérêt de ces expérimentations, c’est qu’elles ne coûtent pas très cher, surtout quand elles sont financées sur le redéploiement de crédits déjà existants. Il n’empêche : alors que les collectivités locales verront leur budget amputé de 6,5 milliards d’euros en 2025, au risque d’affaiblir leur capacité à assurer leurs missions de service public, la question de la pérennité de ces dispositifs se pose. Par exemple, la convention de recentralisation du RSA entre l’Etat et la Seine-Saint-Denis a été signée pour cinq ans. Qu’adviendra-t-il de la Nouvelle Donne de l’insertion en 2027 ? Bonne nouvelle, l’idée a déjà fait des émules, en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales. Surtout, ces innovations sont très «rentables» sur le plan social : le mal-être coûte cher aux finances publiques, et en particulier au budget de la Sécurité sociale, lourdement déficitaire. Dans les territoires qui ont testé le «zéro chômeur de longue durée», un premier bilan tiré en 2019 faisait état d’une «baisse du nombre de colis alimentaires distribués par les associations caritatives équivalente au nombre de personnes recrutées». Preuve que les collectivités locales, pionnières de la France qui essaie, sont aussi capables de transformer l’essai.