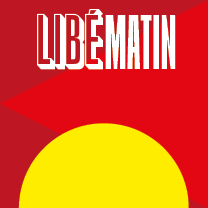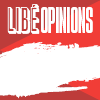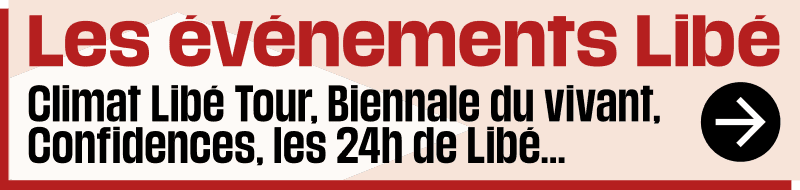Eradiquer la malnutrition dans le monde tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, c’est possible. Et d’ici dix ans, à en croire l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). A condition de s’en donner les moyens, développent les deux institutions dans leur rapport annuel conjoint, «Perspectives agricoles 2025-32», publié mardi 15 juillet.
A lire aussi
Aujourd’hui, l’agriculture et la sylviculture représentent environ 22 % des émissions générées par les humains. «Alors que la demande alimentaire mondiale continue de croître, le défi consiste à réduire l’impact environnemental de la production agricole tout en assurant la sécurité alimentaire», résument-elles.
Une réduction de 7% des émissions
Au vu des projections démographiques, de la croissance des revenus et de l’urbanisation, notamment dans les pays émergents, la consommation alimentaire mondiale devrait augmenter de 13 % dans les dix prochaines années, estiment les deux institutions. Pour y répondre, la production de l’agriculture et de la pêche devraient être en hausse de 14 %. Or les gains de productivité n’y suffiront pas : les surfaces cultivées et la taille des troupeaux devraient augmenter, en particulier en Afrique et dans le sud de l’Asie. L’OCDE et la FAO anticipent ainsi une hausse de 6 % des émissions de gaz à effet de serre dans ces secteurs.
Pourtant, il serait au contraire possible de les réduire de 7 % par rapport à leurs niveaux actuels, tout en relevant la production alimentaire de 10 %. Et cela en augmentant la productivité agricole de «seulement» 15 %.
Des algues anti méthane
Pour être à la hauteur de ces ambitions, outre les efforts globaux de réduction du gaspillage alimentaire, le secteur agricole doit adopter «à grande échelle» les pratiques les plus vertueuses et les «technologies de réduction des émissions» déjà disponibles, exhortent la FAO et l’OCDE.
«Dans le secteur de l’élevage, les technologies d’atténuation visent surtout à réduire les émissions de méthane liées à la fermentation entérique [fermentation digestive chez les ruminants, ndlr], à accroître l’efficacité alimentaire et à améliorer les systèmes de gestion des effluents», précise l’étude. Un meilleur équilibrage des rations alimentaires «avec l’aide de l’intelligence artificielle» ou l’amélioration de la digestibilité des fourrages permettraient par exemple d’atteindre cet objectif de réduction de la production de méthane lors de la digestion.
«L’utilisation d’algues dans l’alimentation des ruminants» en petite proportion permettrait par ailleurs de réduire leur production de méthane, mais «des études plus approfondies sont nécessaires», précise le rapport. En France, le projet Méth’algues, une initiative collaborative lancée en janvier 2021 pour une durée de trois ans et qui a réuni acteurs publics et privés, a conclu que les algues ayant permis une plus forte diminution des émissions par les ruminants «sont peu ou pas présentes sur les côtes françaises». «Leur culture doit encore être améliorée pour permettre des productions à grande échelle, et n’est pas toujours autorisée en mer», explique le Centre d’étude et de valorisation des algues, ayant participé au projet.
«Ces technologies ont été peu adoptées»
Concernant les cultures, il s’agit d’améliorer «l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs» (fertilisants), notamment grâce aux «opportunités significatives offertes par l’agriculture de précision» (applications ciblées via GPS, capteurs…), selon la FAO et l’OCDE. Mais s’en remettre à la technologie n’est pas suffisant. Il faut dans le même temps mettre en place des pratiques agroécologiques pour maintenir ou restaurer la qualité des sols, renforçant ainsi leur capacité à stocker le carbone. La rotation des cultures ou l’absence de labour sont autant de méthodes qui préservent les sols.
A lire aussi
«Cependant, en dépit de leur potentiel technique dans de nombreuses régions, ces technologies ont été peu adoptées» à ce stade, déplore le rapport. Les deux institutions internationales évoquent plusieurs raisons à cela : des coûts d’investissement initiaux élevés, des infrastructures déficientes ou le manque de soutien technique et d’incitations des pouvoirs publics.